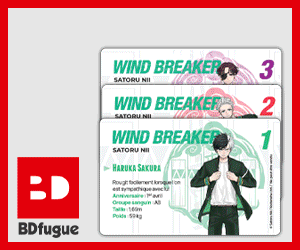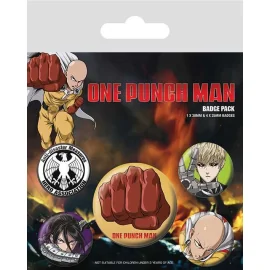Critique du volume manga
Publiée le Vendredi, 24 Janvier 2025
Cette année 2025 sera largement placée sous le signe de Junji Ito chez Mangetsu, au vu de la venue du maître à Japan Expo l'été prochain en tant qu'invité d'honneur, et des différents ouvrages prévus chez l'éditeur pour l'occasion. Et afin de bien commencer cette année, Mangetsu nous propose, dès ce mois de janvier, de découvrir Décapitées.
De son nom original "Kubi no nai chôkoku", ce recueil, initialement paru au Japon en 1991, a ensuite fait son retour chez l'éditeur Asahi Shimbun en 2013 dans une version enrichie pour la collection "Junji Ito Masterpiece". C'est évidemment sur cette dernière édition que se base la version française qui, sur près de 400 pages, nous propose de découvrir les 12 histoires courtes que l'auteur a conçues pour le magazine Gekkan Halloween entre novembre 1990 et février 1992. Il s'agit donc de récits de début de carrière du mangaka, et de la suite logique du Déserteur, recueil sorti en France en juin 2024 et qui regroupait les premières histoires courtes de la carrière du maître, datant d'entre juillet 1987 et novembre 1990. Comme souvent avec les recueils d'Ito, certains des récits ici présents ont déjà pu être découverts auparavant en France dans d'autres publications (les anciennes publications des éditions Tonkam, les Chefs d'Oeuvres chez Mangetsu...), à l'image de celles intitulées "Le Pont" et "Le cirque est là !".
Un "fil du destin" beaucoup trop capricieux envers un jeune garçon récemment plaqué par sa petite amie avec qui il se pensait lié pour la vie. Un vinyle légendaire et unique qui obsède beaucoup trop les personnes qui l'écoutent. Une malédiction jetée à un homme dangereux et détestable en tous points pour qu'il devienne enfin généreux. Un étrange rite funéraire dans un village reculé. Un cirque où s'enchaînent les accidents mortels sous les yeux écarquillés des spectateurs. Une obsession pour les frelons qui risque de mal tourner. Une ville dont les plans ont de quoi rendre fou. L'assassinat mystérieux d'un professeur d'art connu pour ses sculpture sans têtes. La transformation progressive et insondable d'adolescentes devant soudainement très, très belles. Une maison voisine dont la jeune habitante semble touchée par une maladie lui faisant des trous dans les bras. Des épouvantails prenant l'apparence de défunts. Et les dernières volontés sinistres d'une jeune fille qui s'est suicidée.
Voici donc, dans les grandes lignes, le programme d'un recueil qui, comme prévu, nous apparaît comme la suite logique du Déserteur, recueil qui proposait déjà à la fois son lot d'idées mais aussi de maladresses dues à une évidence: le "jeune age" d'Ito en tant que mangaka, lui qui était alors dans une période de reconversion vouée à ensuite lui faire laisser tomber son étouffante carrière de dentiste. Avec Décapitées, on découvre des histoires qui ont encore des maladresses, et cela pour une raison: à l'heure où il commence à se consacrer pleinement et exclusivement à sa carrière de mangaka, on sent qu'il tâtonne, qu'il tente des choses, quitte à alourdir certains récits avec des éléments pas forcément nécessaires: alors que le non-dit deviendra plus tard l'une des marques de fabrique ayant fait une partie du succès d'Ito, ici il se perd parfois en voulant être au contraire trop bavard, trop explicatif... et sans doute sont-ce ces expériences un peu plus inégales qui lui ont, ensuite, permis de peaufiner son style, d'épurer ce qui devait l'être, d'être plus évasif pour mieux susciter notre effroi face à l'étrangeté des situations qu'il met en scène. En somme, on a envie de dire que les maladresse de plusieurs histoires de ce recueil ont sûrement été une étape essentielle, sans lesquelles nous n'aurions peut-être pas eu le Junji Ito au meilleur de sa forme que nous avons connu pendant les années suivantes. Et puis, même si ce côté parfois trop bavard et explicatifs et ces éléments superflus peuvent sembler un peu poussifs, d'un autre côté on ressent parfois un certain "amusement" à voir quelques personnages tenter assez vainement quelque chose de typiquement humain: chercher à expliquer l'inexplicable.
Pour, justement, rester sur le sujet de la nature humaine, il est également intéressant de voir que, dans toutes ces histoires, même s'il y a toujours une très forte part d'étrange et d'inexplicable, cette teneur surnaturelle et défiant toute rationalité appuie souvent les limites, la folie, les bassesses humaines, qui sont généralement ici ce qui finit par angoisser le plus. Junji Ito joue ainsi sur pas mal de sujets humains: les apparences, l'amour fou, l'obsession pour la beauté, la jalousie, l'appât du gain, l'obscurantisme, l'égoïsme, la difficile acceptation du deuil, la psychose, la paranoïa... Tout comme, bien souvent, met beaucoup en scène des relations humaines bancales et ne pouvant souvent trouver que des issues fatales, et cela dès la première histoire qui en est un très bon exemple.
Enfin, sur le pur plan visuel, même si l'on sent constamment que l'on est sur du Junji Ito encore en début de carrière et pas totalement abouti, on voit aussi la patte graphique typique du maître s'affirmer petit à petit sur certains gimmicks et certaines représentations de l'horreur. Mieux, quelques moments de mise en scène, de cadrages, sont particulièrement réussis, à l'image fuite de Rumi dans les couloirs pendant l'histoire donnant son nom au recueil.
En somme, au fil de ce recueil nous gratifiant quand même d'un paquet de bons moments, on voit un Junji Ito qui tâtonne, qui teste quitte à parfois se cogner contre un mur, mais qui progresse alors de plus belle en continuant de peaufiner son style et ses gimmicks. L'ensemble est certes inégal, mais reste évidemment indispensable aux plus grands fans du maître pour bien cerner ses évolutions.
Quant à l'édition française, elle est à nouveau très qualitative, avec le grand format rigide et assez luxueux typique de la collection, une jolie jaquette bien conçue par Tom "spAde" Bertrand et dotée d'un marquage métallisé rouge sur le logo-titre, un papier qualitatif permettant une très bonne impression, une traduction impeccable d'Anaïs Koechlin, un lettrage propre de Martin Berbérian, une postface signée cette fois-ci Patrick J. Gyjer (toutefois ne me demandez pas qui c'est, je n'en sais absolument rien, et comme d'habitude l'éditeur ne le précise malheureusement pas), et surtout l'habituelle excellente analyse de Morolian, passionnante à suivre, surtout par la contextualisation de la vie d'Ito au moment où il a conçu ces histoires.

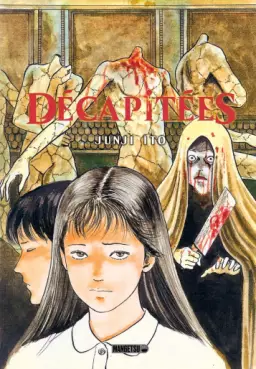 22/01/2025
22/01/2025