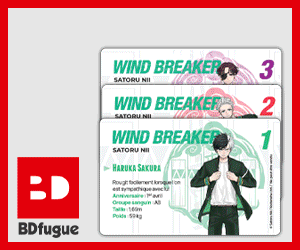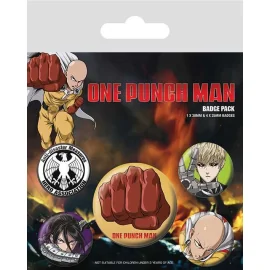Critique de l'anime : IGPX - Immortal Grand Prix
Publiée le Mardi, 09 Décembre 2014
En 1999, le cinéma fantastique, et par extension la représentation même de la peur, revêt un nouveau visage. Cette petite révolution est en provenance directe du Japon et se nomme Ring. Depuis, le cinéma international n’en est toujours pas revenu avec d’innombrables ersatz peuplés de filles aux cheveux gras, mais c’est aussi le cas en littérature et dans le manga. Après l’adaptation papier de Ring, débarque l’autre grande franchise, Ju-On : The Grudge.
Si le Japon et ses cinéastes ont changé la face du cinéma fantastique pour un bon moment, cela ne s’est pas fait dans la simplicité. Ainsi, Hideo Nakata, réalisateur de Ring et sa suite japonaise, s’est vu confier les rennes du remake américain du deuxième. Un imbroglio qui devrait continuer puisque le même Nakata est sur les rangs pour réaliser le remake toujours américain de The Eye des frères Oxide et Danny Pang. Comme si ce n’était déjà pas assez compliqué, un réalisateur s’est retrouvé à tourner trois fois, enfin en quelque sorte, le même film, trois sa suite, etc… En l’an 2000, Takashi Shimizu écrit et met en scène une histoire de malédiction pour le marché de la vidéo. Tourné en DV et avec une économie de moyens, le film remporte une énorme succès auprès du jeune public, ce qui le pousse à mettre en boîte une suite la même année. A l’image du premier Ring un an plus tôt, Ju-On devient vite un phénomène de société, ou du moins l’une des ses plus célèbres représentations, et est porté au grand écran par deux fois trois ans plus tard. Comme si cela ne lui suffisait pas, Takashi Shimizu cède même aux sirènes d’Hollywood et réalise lui-même le remake américain de son propre film sur un scénario mixant les deux montures, vidéo et cinéma. Il devrait d’ailleurs de retour derrière la caméra pour la suite, alors même qu’il vient de boucler Ju-On : The Grudge 3 au Japon, cinquième (tout de même !) et dernier opus de la franchise.
Du cinéma au manga
Au-delà de ce jeu des chaises musicales, à la limite parfois du ridicule (surtout à la vue du Cercle 2 de Hideo Nakata), les deux franchises Ring et Ju-On ont en commun d’avoir défini un panel de figures et de représentations aujourd’hui incontournables : les filles aux cheveux gras, des gamins fantomatiques et parfois miauleurs (!!), les ombres sur les caméras de surveillance et surtout la force du non-dit, du sous-entendu. Plus besoin de portes qui claquent, de grossiers effets spéciaux ou de violons stridents, un simple sac d’école rose (Dark Water toujours de Hideo Nakata), l’image fixe d’un puits ou un enfant pâle caché dans un coin de la pièce, du plan, et le poil du spectateur est hérissé. Des procédés exclusivement cinématographiques dont l’adaptation en bande dessinée, même si la mise en page d’un manga fait parfois penser à une mise en scène, peut s’avérer délicate, voire impossible. De là à dire que l’adaptation en manga de ces succès du cinéma et de l’horreur est avant une opération lucrative, il n’y a qu’un que chacun choisira de franchir ou pas. Toujours est-il que pour accorder le minimum de crédibilité à ces mangas, le scénario est à chaque fois signé par le scénariste des films. Dans le cas de Ring, le scénariste Hiroshi Takahashi s’est occupé des deux premiers tomes couvrant la même histoire que le film, avec Misao Inagaki au dessin. Deux autres tomes parallèles, Ring 0 et Ring : Birthday reprennent les idées originales de l’auteur des romans, Kôji Suzuki, avec cette fois Meiwu au dessin. Un mangaka au style oubliable, comme le prouvent ses deux seules œuvres sorties en France, Gasaraki et Kikaider. Pourtant, c’est bien lui que l’on retrouve à l’œuvre sur Ju-On, du moins le deuxième volume. Ne vous inquiétez pas, le jeu des chaises musicales ne recommence pas.
Dessinez, c’est pas gagné
La présence de Takashi Shimizu au scénario du manga en deux volumes sonne plus comme une caution que comme une réelle implication du réalisateur dans l’histoire. Surtout que celle du premier volume est une copie carbone du premier Ju-On en vidéo. Un gage de qualité, puisque ce film est peut-être le seul avec Ring à vraiment faire peur. Du genre à en faire des cauchemars la nuit suivante. Pourquoi alors la lecture du tome 1 est si embarrassante, ennuyeuse, inutile ? La faute à la dessinatrice Miki Rinno, qui même si elle a remporté un concours de jeunes talents dans la catégorie dessin d’horreur, ne fait qu’illustrer platement les situations, les saynètes. Les apparitions du fantôme du gamin tombent toutes à l’eau, sans exception, et seuls les effets gore détonnent dans un récit heureusement linéaire, contrairement à celui du film. Ainsi, un père de famille cherche un nouveau logement jusqu’au jour où une agence lui propose une affaire en or. Une grande maison, calme, près des écoles et de la gare, et à un prix dérisoire. Mais tout cela a une raison précise, en effet, la maison a été le théâtre d’une nuit sanglante, et les esprits vengeurs rodent encore. Dans un style entre du mauvais manwha et du tout aussi mauvais shôjo, Miki Rinno ne surprend que lors d’une scène, la seule à ne pas être dans le film : une attaque spécialement graphique de chatons. La victime en a encore le goût dans la gorge.
Psychologie de l’horreur
Le deuxième tome, dessiné par le faiseur Meimu, rehausse pourtant le niveau. Le trait est plus fin, le cadrage plus travaillé, et surtout les mises à mort font preuve d’un peu d’imagination. Même le gamin miauleur a le droit à des représentations originales, dans la pénombre d’une case ou sur le toit d’une voiture. Malheureusement, le récit directement inspiré du scénario du deuxième film cinéma (vous suivez ?) est complètement décousu et difficile à suivre. Harase Kyôko est une star du cinéma d’horreur en proie au doute. Le jour où elle est invitée à une émission de télé sur une maison hantée, la fameuse maison, elle a un mauvais pressentiment. Bien sûr, les cadavres tombent comme des mouches et elle-même est victime d’un accident de la route où elle perd le bébé qu’elle attendait. Sauf que son médecin lui assure que la grossesse se déroule bien. La fin est bien entendu inéluctable, mortelle naissance donc, sauf que les personnages sont si mal croqués, leur psychologie si peu développée, que la lecture du manga tend à ressembler à tourner les pages, subir les morts sans réelle tension. En effet, le concept du film, et par là même du manga, est une succession de morts sur la base d’une malédiction, soit un matériel propice aux expérimentations visuelles. Ce qui n’est pas du tout le cas dans le manga. D’ailleurs est-ce possible ? Les meilleurs mangas d’horreur ont toujours réussi à créer un univers, une ambiance, un personnage central, au moins, afin d’embarquer le lecteur avec lui et le surprendre soit par l’histoire, soit par le dessin. Deux exemples, et conseils, de lecture hautement plus recommandable : Spirale de Ito Junji et La Dame de la chambre close de Minetaro Mochizuki (Dragon Head).
Hoagie