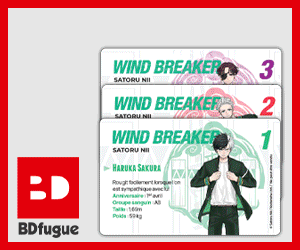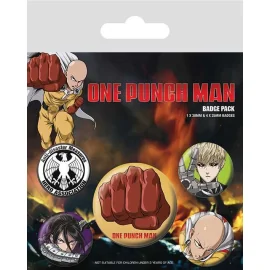Critique du volume manga
Publiée le Vendredi, 22 Novembre 2024
Fusako Kuramochi fait partie de ces autrices de manga qui restent relativement méconnues au-delà des frontières japonaises et qui, pourtant, ont eu une influence considérable dans l'évolution de la très large et diversifiée catégorie éditoriale qu'est le shôjo. Poursuivant sa carrière depuis 1972 quasiment exclusivement dans le shôjo/josei, elle est réputée non seulement pour avoir su renouveler son style au fil du temps tout en en gardant l'essence (son trait restant toujours assez identifiable), mais aussi et surtout pour avoir été l'une des premières mangakas shôjo à apporter une dimension psychologique plus réaliste à ses héroïnes, alors même que ses histoires, au premier abord, gardent le plus souvent des allures de romance naïves et pures. C'est plus particulièrement dans les années 1980 qu'elle a eu une grande importance: à une époque où la bulle économique persistait au Japon et où une nouvelle génération s'ouvrait toujours plus à la culture venue de l'étranger (en particulier sur le plan musical), et a su toucher nombre de lectrices grâce à des héroïnes qui, précisément, étaient bien ancrées dans ces changements de l'époque, si bien qu'il était très facilement possible de se retrouver en elles, et que son travail de manière générale a eu une influence considérable sur des autrices de mangas aujourd'hui internationalement reconnues, en têtes desquelles Ai Yazawa. Puis dans les années 1990, Kuramochi n'a fait que confirmer toutes ses qualités en continuant de marquer les esprits, jusqu'à même être récompensée en 1996 du Prix du shôjo de l'année par les éditions Kôdansha, pour une série pourtant parue chez le concurrent Shûeisha (ce type de prix restant assez rarement attribué aux éditeurs concurrents, surtout les plus gros): Tennen Kokekko, qui était jusque-là l'unique oeuvre de Kuramochi à avoir été publiée en France, entre 2010 et 2013, sous le titre "Simple comme l'amour", par Akata à l'époque de leur collaboration avec Delcourt.
C'est précisément Akata, devenu éditeur indépendant à part entière depuis dix ans, qui remet enfin l'autrice en avant en France en c emois de novembre, fort logiquement dans la collection Héritages, avec une oeuvre en deux tomes qui est pour l'occasion compilée en un seul pavé d'environ 380 pages. Le choix de publication d'A-Girl n'est pas anodin, car même si ce manga n'est pas parmi les plus connus de la mangaka, selon l'éditeur il représente très bien toutes les spécificités du style de l'autrice dans les 80s, et nous verrons plus tard que c'est tout à fait vrai.
Récit de presque 300 pages initialement paru au Japon entre juillet et décembre 1984, A-Girl nous immisce auprès de Mariko Senô, jeune lycéenne de 17 ans qui n'a plus de parents et qui vit avec sa grande soeur Mayuko. Là où Mayuko est une fille de caractère et qui semble plutôt savoir ce qu'elle veut, Mariko, elle, est généralement perçue comme une adolescente naïve, ce qui fait qu'elle laisse sans doute passer trop de choses à son petit ami Goshima (enfin, Godzilla selon Mayu), camarade de classe et rocker populaire qui a toutefois le sang chaud et qui a tendance à facilement la frapper quand il s'énerve (et malheureusement, ça arrive souvent). Les choses pourraient s'arrêter là, à ceci près que dans le même immeuble que les deux soeurs vit aussi Ichirô Natsume, beau gosse, mannequin et star du lycée, que beaucoup de filles admirent, mais sur qui Mariko a entendu certaines rumeurs peu élogieuses. Pourtant, quand une partie de l'immeuble brûle dans un incendie et que les deux soeurs sont temporairement accueillies chez lui par Natsume, elles découvrent un garçon très gentil, serviable, faisant même miroiter à Mariko la possibilité de vivre le grand amour avec lui car elle lui plaît... Il ne faudrait alors pas grand chose pour que Mariko et Mayuko, comme tant d'autres personnes, craquent pour lui, quand bien même tout porte à croire qu'il est très frivole en matière de relations amoureuses.
Oeuvre charnière dans la bibliographie de Kuramochi, A-Girl fait partie de ces titres qui cristallisent bien la dualité assez unique de la mangaka à cette époque: bien qu'elle ait hérité du côté "romance naïve et pure" de certains grands noms du shôjo qui l'ont bercée quand elle était jeune, elle insuffle à son histoire d'amour ce fameux aspect un plus réaliste, que nous évoquions plus haut, dans la psychologie de ses personnages. Ainsi, derrière son côté parfois presque mièvre et trop passif sur certains points (on pense surtout à ce que Goshima lui fait subir), mine de rien Mariko réfléchit beaucoup sur sa propre manière de rester accrochée à un petit ami certes franc et sincère mais violent, ainsi que sur ce qu'elle se met à ressentir pour Natsume, garçon a priori bien plus bienveillant mais aussi bien plus frivole. Même si ce n'est pas hyper poussé (puisque rappelons encore que, à cet époque, cet aspect plus réaliste était très peu existant dans les oeuvre du genre), il y a de quoi s'attacher à cette jeune fille qui cherche à remettre en question son couple et, au bout du compte, à changer pour mieux se prendre en main et atteindre ce qu'elle veut, en essayant de devenir un "A-Girl" comme sa soeur le dit. Et c'est aussi parce qu'on s'attache aisément à elle que l'on s'agace tout autant en la voyant laisser trop facilement passer certaines choses concernant son petit ami, cette dualité chez elle ne manquant pas de rappeler un personnage comme Nana "Hachiko" Komatsu de la série culte NANA d'Ai Yazawa, inspiration qui n'aurait rien d'étonnant quand on sait qu'Ai Yazawa a déjà revendiqué l'influence de Fusako Kuramochi, d'autant plus que les deux oeuvres ont aussi pour point commun un ancrage dans l'univers du rock et de certaines de ses frasques. Autour de Mariko, enfin, gravitent quelques personnages qui, de Mayuko à Natsume en passant par Goshima, n'ont rien de secondaire, tant ils ont leur place de premier plan à part entière eux aussi, avec leur personnalité bien définie, leurs qualités et défauts, leur évolutions intérieures et relationnelles.
Mais il reste que, pour apprécier la lecture au-delà de l'"héritage" qu'elle représente, il faudra tout de même passer outre deux aspects qui pourraient rebuter, le premier des deux étant justement l'ancrage de l'histoire dans son époque. Une époque où certains comportements étaient moins sévèrement repris qu'aujourd'hui: il serait presque impensable, de nos jours, de voir Goshima cogner Mariko sans qu'il reçoive plus de représailles ou sans que ça choque plus fermement l'entourage, et il faut ainsi toujours penser à remettre l'oeuvre dans son contexte au fil de la lecture. A partir de là, il devient plus aisé de plutôt se focaliser sur le difficile mais réel début de remise en question voire d'émancipation de Mariko, à une époque où ce type de chose était sûrement moins évident qu'aujourd'hui. L'autre aspect bancal est plus certain: toute la dernière partie va bien trop vite dans les évolutions intérieures et relationnelles, on aurait vraiment aimé que la mangaka ait l'occasion de prendre un peu plus son temps pour mieux les amener par étapes.
Enfin, soulignons qu'après les presque 300 pages composant A-Girl, les 80 dernières pages proposent de découvrir deux histoires courtes. La première, centrée sur une lycéenne qui a facilement la tête dans les nuages et qui aimerait devenir mangaka ainsi que sur un garçon un peu loubard (un duo assez récurrent dans les shôjo de cette période), baigne aussi très bien dans son époque (là aussi, le rock n'est pas loin), possède une ambiance mélangeant également une part de naïveté à un aspect plus réaliste dans l'abord des personnages, et a le mérite de tenter une fin surprenante. Quant à la deuxième, elle n'a pas grand intérêt puisqu'il s'agit de l'épilogue d'une autre série de l'autrice: Tokyo no Casanova, une série inédite en France à ce jour et dont A-Girl est parfois considérée comme un spin-off ou une suite.
A l'arrivée, il faut lire avant tout A-Girl comme un pur représentant de la collection Héritages d'Akata: si le charme tout à fait personnel du style graphique de Fusako Kuramochi opère toujours aussi bien au fil du temps (pour peu qu'on soit sensible à ce style, bien sûr), dans son récit l'oeuvre a forcément vieilli, précisément parce qu'elle se voulait avant tout bien ancrée dans son époque dès sa publication initiale. Et sur ce point-là, il est certain qu'A-Girl était moderne et réaliste à l'époque où l'oeuvre fut créée. Ainsi, on y retrouve bien tout la particularité de cette autrice, parfois qualifiée par Akata (à juste titre) de chaînon entre les shôjo "d'avant" ancré dans l'imaginaire ou la naïveté, et l'évolution de toute une part de cette catégorie éditoriale plus psychologique, plus réalistes et ancrées dans le quotidien de leur époque.
Concernant l'édition française, Akata livre une excellente copie. Derrière une jaquette dotée de la sobre charte graphique typique de la collection héritage et soigneusement travaillée par Carla Ferreira, on trouve un papier souple, certes un peu fin mais suffisamment opaque et facile à manipuler, ainsi qu'une bonne impression, un lettrage très propre de Tom "spAde" Bertrand et une traduction impeccable de David Pollet. Surtout, en guise de suppléments, Akata a eu l'excellente idée d'inclure une petite galerie d'illustrations en couleurs sur papier glacé (reprenant entre autres les illustrations de couvertures de l'édition japonaise), et une belle postface de trois pages dans laquelle le directeur éditorial Bruno Pham revient avec clarté, dans les grandes lignes, sur le parcours de Fusako Kuramochi, sur ce qu'elle représente, et sur la place d'A-Girl dans sa carrière.

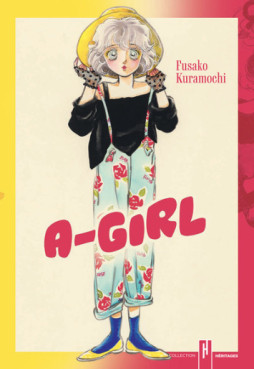 21/11/2024
21/11/2024