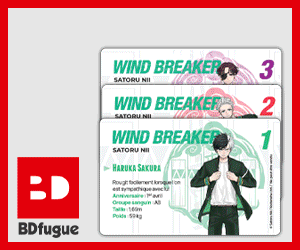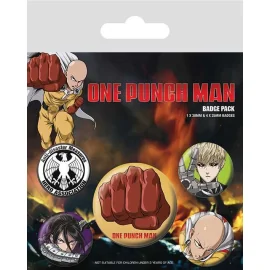Critique du volume manga
Publiée le Mercredi, 27 Février 2013
En 1957, alors qu’il a à peine 22 ans, Yoshihiro Tatsumi ne se reconnaît déjà plus dans les canons du manga que lui ont inculqués ses pairs. Il le considère bien comme une « image dérisoire » (traduction littérale de manga), cantonnée à divertir et à dérider lecteur. Il décide de s’en détacher par un acte symbolique, en créant son propre style de bande dessinée : le gekiga – de geki : drame. Suit la même année la création d’un atelier du gekiga avec six jeunes dessinateurs alternatifs, dont un certain Taka Saito. Après 35 ans et 136 volumes de bons et loyaux services, son célèbre Golgo 13 continue de sévir chez l’éditeur japonais Leed sha. Tous s’inscrivent dans une même veine : la chronique sociale ultra réaliste, brute, frontale. Tant sur la forme que sur le fond, le gekiga témoigne d’un mal-être. A priori d’un seul individu, ou d’un groupe. Mais ces œuvres sont en fait de véritables radiographies d’une époque, d’une société, et surtout de ses travers. Ce n’est pas un hasard si le genre a connu son heure de gloire lors des mouvements sociaux et étudiants des années 60-70 au Japon.
Découvert en France dès 1980
La majorité des bandes dessinées de Yoshihiro Tatsumi ont été publiées avant 1984, la plupart dans des revues hebdomadaires. C’est à cette époque, que les Français découvrent son travail à travers la revue, aujourd’hui culte, Le Cri qui tue. Fondée en 1978 par le gentiment excentrique Atoss Takemoto et basée en Suisse, elle permit de découvrir pendant quatre ans et six numéros des auteurs japonais en français dans le texte : Osamu Tezuka que l’on ne présente plus, Taka Saito, encore lui, et Yoshihiro Tatsumi. Ainsi, dès 1983, l’éditeur Artefact publie un premier recueil, Hiroshima, suivi en 1988 par un autre, Coup d’homme, par les Pseudo-Éditions du 141ème Ciel cette fois-ci. Il faudra attendre les indépendants de chez Vertige graphic pour apprécier plus exhaustivement son œuvre, avec trois recueils : Coups d’éclat, Les Larmes de la bête et Good bye. Ce dernier regroupe quatre histoires d’époques disparates, de 1960 à 1998 en passant par 1984 pour La grue de papier.
La marginalité dans tous ses états
Dès la première bulle, la nouvelle donne le ton : « Je ne peux pas continuer comme ça, je n’ai pas assez confiance en moi. » Cet étudiant japonais, à l’intégration problématique parmi les Français - « froids et prétentieux comme leurs monuments » -, et surtout parmi les femmes, est un “digne” représentant des personnages désabusés, torturés, peints par Yoshihiro Tatsumi. S’il ne porte jamais aucun jugement de valeur sur eux, il ne leur laisse pas non plus beaucoup d’échappatoires ou d’espoirs. Condamnés avant l’heure, ces derniers prennent l’apparence d’ombres. Marginalisés à l’extrême, ils errent dans univers poisseux, glauque, à l’image de leur for intérieur. Ce parcours, toujours introspectif, suit souvent une progression du récit surprenante, et permet à l’auteur de sonder les âmes, victimes collatérales d’une machine sociale sans pitié. Le constat est donc pessimiste, fataliste même, mais il se révèle rare dans la production manga actuelle, et donc nécessaire.
Sa dernière œuvre en date est un récit autobiographique, Gekiga Hyoryû (Un rescapé du gekiga) et est publiée depuis 1995 dans le magazine Mandarake Zenbu.

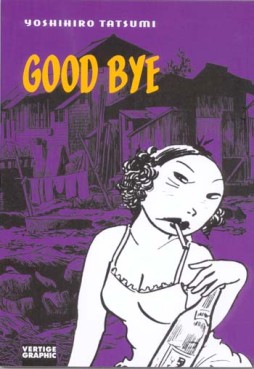 17/02/2005
17/02/2005